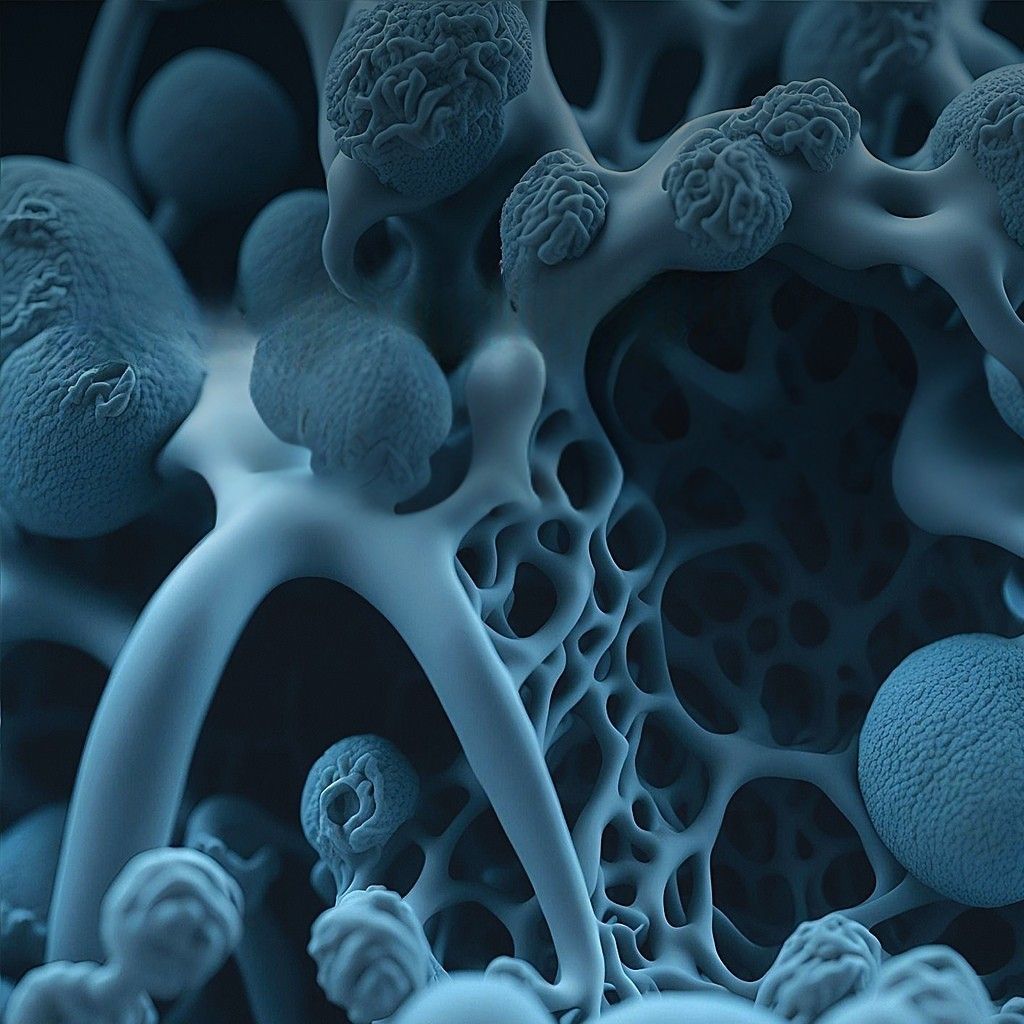par Martin Mercier, t.p. conseiller en grandes cultures, Agrocentre Technova inc.
•
18 septembre 2025
Le blé d’automne gagne en popularité au Québec, et pour de bonnes raisons. Cette année, avec un printemps plutôt capricieux, le blé d’automne a été très apprécié, diminuant la charge de travail printanière. Grâce à une meilleure utilisation de la saison de croissance, cette céréale peut offrir des rendements supérieurs à ceux du blé de printemps, tout en s’intégrant dans des rotations culturales diversifiées. Toutefois, pour exploiter pleinement son potentiel, plusieurs facteurs doivent être soigneusement maîtrisés : la fertilisation, la population, le choix de la méthode de semis et, surtout, le respect de la fenêtre optimale de semis. Fertilisation La fertilisation du blé d’automne lors de l’implantation joue un rôle déterminant dans la réussite de la culture, particulièrement dans le contexte québécois, où l’hiver impose une longue pause végétative. L’objectif principal est de favoriser une bonne implantation avant le gel, sans stimuler une croissance excessive qui nuirait à la survie hivernale. Le défi réside donc dans l’équilibre entre les besoins pour le démarrage et une bonne préparation à la saison hivernale de la plante. Azote (N) L’apport en azote (N) doit soutenir l’établissement du blé (développement racinaire, premières talles) sans favoriser une croissance excessive du feuillage, ce qui rend les plants plus vulnérables à l’hiver. Pour ceux qui n’utilisent pas de fumier, je vous conseille le sulfate d’ammonium (21-0-0-24S), un produit qui permet une excellente couverture du sol en raison de sa concentration plus faible, avec un apport de soufre très bénéfique pour la culture. Certaines fermes disposant de fumier ou de lisier l’utilisent en pré-semis ou immédiatement après, surtout sur des sols pauvres en matière organique. Dans ce cas, une analyse du fumier et du sol est essentielle, car l’azote organique minéralisé peut suffire pour l’automne. Qu’en est-il de l’apport d’azote au printemps ? Considérant un climat de plus en plus incertain, l’application d’azote très tôt au printemps, sous forme de sulfate d’ammonium, peut permettre d’attendre une application optimale au tallage, diminuant les stress dus à une carence azotée pouvant survenir si des périodes pluvieuses nous empêchent d’agir au bon moment. Cela facilite grandement l’atteinte des objectifs fixés, tout en permettant d’appliquer un programme complet de fertilisation sans embûche. Phosphore (P) : la clé de l’enracinement Le phosphore (P) est sans contredit l’élément le plus important à apporter à l’automne pour le blé d’automne. Il favorise la croissance racinaire, essentielle pour une bonne implantation et une meilleure reprise au printemps. Je vous recommande l’utilisation du MESZ (12-40-0-1Zn-10S) pour combler vos besoins en phosphore. Le MESZ est le seul produit sur le marché qui contient, en plus du phosphore, du soufre sous deux formes différentes, pour un apport tout au long de la saison, ainsi que du zinc qui joue un rôle crucial dans le développement racinaire. Potassium (K) : ne pas négliger sur sols sableux Même si le potassium (K) a une influence plus importante au printemps, il ne doit pas être négligé à l’automne. Il augmente la concentration en sucres dans la plante, ce qui améliore la survie hivernale. D’autres rôles importants joués par le potassium incluent l’augmentation de la production de lignine (liée à la tenue), l’amélioration de la résistance naturelle aux attaques fongiques et au stress hydrique, ainsi que l’augmentation de la taille des fruits, donc du grain dans le cas des céréales. En Europe, les producteurs de céréales d’automne réalisent en moyenne des apports de 100 unités fertilisantes de potassium par hectare, en diversifiant les sources d’engrais. On parle généralement de 40 unités apportées par le K-Mag (0-0-22-11Mg-22S) et de 60 unités par l’Aspire (0-0-58-0,5B), ce qui assure un apport de plusieurs éléments (ex. : bore, soufre, magnésium), en plus des deux formes de potassium se libérant à différents moments dans la saison. Il est donc important d’appliquer une partie à l’automne, considérant nos printemps plutôt incertains, pour faire une bonne gestion des risques et s’assurer d’une disponibilité constante. Population et taux de semis : viser la juste mesure Le taux de semis est un levier agronomique majeur pour assurer une bonne couverture du sol avant l’hiver et un rendement optimal à la récolte. Il doit être adapté en fonction de la date de semis, du type de sol, de la méthode d’implantation (semoir ou semis à la volée), et des conditions de levée. En conditions idéales, le blé d’automne peut produire 2 à 3 talles fertiles par plant. Pour atteindre un objectif de 500 à 700 épis/m² au printemps, il est donc généralement recommandé de semer entre 350 et 450 grains viables/m² à l’automne. Cela correspond, selon la grosseur du grain et le taux de germination, à environ 150 à 220 kg/ha pour la plupart des cultivars utilisés au Québec. Il est important d’ajuster la dose en fonction du PMG (poids de mille grains), qui varie selon les variétés. Petite réflexion : les records mondiaux visent plus entre 1 000 et 1 300 épis/m². Faites vos calculs et laissez-vous tenter par des essais de population sur votre ferme ! Semis au semoir ou semis à la volée ? Tout dépend de l’équipement disponible sur la ferme et de l’avancement des autres cultures. Semis au semoir : plus précis, plus économique Les semoirs à céréales permettent une répartition régulière et un bon contrôle de la profondeur, favorisant une levée uniforme. En sol bien préparé, cette méthode permet d’utiliser une dose plus économique, soit souvent entre 150 et 175 kg/ha, selon le cultivar. Semis à la volée : compenser en augmentant la population Cette méthode est de plus en plus utilisée, notamment en semis simplifié, après une culture hâtive ou même dans le soya avant la chute des feuilles. Le semis à la volée est rapide et réduit les passages, mais il génère une distribution moins uniforme et une profondeur d’enracinement irrégulière. Dans ce cas, il est recommandé d’augmenter le taux de semis de 10 à 20 %, voire plus selon le type de recouvrement (rouleau, herse, léger travail du sol). Une dose de 185 à 240 kg/ha est courante. Date de semis maximale : jusqu’où peut-on retarder sans compromettre l’implantation ? Le bon moment pour semer le blé d’automne se situe entre trop tôt (croissance excessive) et trop tard (insuffisance de tallage et mauvaise survie hivernale) ! Fenêtre optimale de semis au Québec : • Zone 3 (Laurentides, régions froides) : 1er au 15 septembre • Zone 4 (Estrie, Montérégie centre, Centre-du-Québec) : 5 septembre à début octobre • Zone 5 (Montérégie sud, vallée du Saint-Laurent) : jusqu’à début octobre Objectif : que le blé ait développé 3 à 4 feuilles et initié le tallage avant les gels profonds, pour bien résister à l’hiver. Règle tout-terrain : semer environ 6 semaines avant le gel permanent du sol. Si le semis est retardé : • Augmenter le taux de semis de 10 à 15 % ; • Limiter l’azote à l’automne pour favoriser l’endurcissement ; • Utiliser un semoir pour maximiser la levée et compenser la plus courte période d’implantation. Réussir son blé d’automne, une affaire de précision Le blé d’automne offre un fort potentiel de rendement, mais il exige une planification rigoureuse dès l’implantation. Une fertilisation bien dosée, particulièrement en phosphore, et un taux de semis adapté à la méthode utilisée sont les bases d’une culture réussie. À retenir pour maximiser vos résultats : • Viser un semis de 350 à 450 grains viables/m² • Fertiliser selon les besoins réels du sol, notamment en P et K (une partie), idéalement à l’automne • Adapter la méthode de semis aux conditions de champ • Respecter la fenêtre optimale de semis pour favoriser tallage et enracinement En misant sur une planification rigoureuse dès l’automne, vous mettez toutes les chances de votre côté pour récolter un blé robuste, homogène et rentable !